
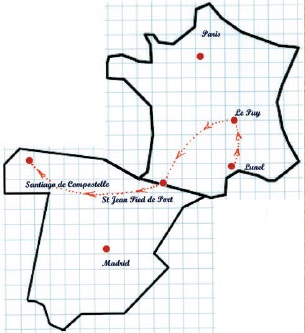
|
Chapitre 47PÉNÉLOPE ET LE NEGRO D’HORNILLOSUn pèlerin a toujours le pas de celui qui pense que le chemin est infini.
Depuis hier, je suis dans la meseta, hauts plateaux entourés de chaines de montagnes ; rien que le nom fait frémir certains pèlerins, au point de leur faire prendre le train pour éviter l’enfer jaune. Ces plateaux représentent à peu près la moitié de l’Espagne, dont les terres sont utilisées à la mono culture intensive ; mieux vaut ne pas se trouver là pendant les épandages. Le chemin coupe cette région, en partie haute, sur deux ou trois cents kilomètres.
Je dois être un peu tordu mais c’est mon dada, j’étais heureux de m’attaquer à tous ces kilomètres, là où il n’y a rien à faire à part mettre un pied devant l’autre et rien pour combattre la monotonie des champs de blé. Aucun détail, aucun paysage pour vous voler l’attention. L’espace à perte de vue et moi seul avec mes pieds, mes chaussures et mes bâtons, à qui je rendais grâce tous les jours. Je me voyais déjà comme le héros d’anciens films : partir le matin fixant l’horizon, le regard scrutateur me préparant à l’assaut du vide. Parce que, quand il n’y a absolument rien on se retrouve seul, face au vide : rien à regarder, rien à penser, rien à entendre. Plus je marchais, plus je montais en pression, plus je me vidais, plus je me régalais. Je comprenais à ce moment pourquoi j’avais fait tous ces kilomètres : c’était pour être là, c’est ici même que j’entreprendrais le véritable voyage intérieur. J’étais à l’orée de l’enchantement de l’inconsistance intellectuelle. J’allais retrouver la sensation de quand j’étais petit, quand le temps était long, quand je n’avais rien à me raconter… La plénitude serait là, face à moi. Néanmoins, dans mon euphorie, il fallait que je me contrôle pour arriver jusqu’au bout ; je devais gérer mes possibilités et les délais. Ni trop, ni pas assez, était ma devise depuis le début et le serait plus précisément ici. Y aller douce manette, tel un bon vieux diesel qui se ménage ; ah, de bons plaisirs se présagent ! Je ne raconterai pas la soirée d’hier qui, pour la première fois depuis mon départ, m’a laissé un goût amer. Je ne cacherai pas que c’était à Hornillos, plus précisément à l’albergue el alfar, qui ne mérite pas de majuscules tellement ils sont petits. Donc, hier soir, à l’albergue el alfar minuscules, on n’aime pas les Français. Tout du moins, les autres nationalités y sont mieux reçues, y compris les Allemands, surtout les Allemands d’ailleurs qui, leurs représentants présents, comme le taulier, m’ont pensé insignifiant, transparent, inexistant. C’est la première fois que je suis victime de sectarisme, pour ne pas dire de racisme ; j’imagine la piètre réception d’un Réunionnais qui cumule les tares : Français et Black à la fois. Pour une fois, je ne mettrai pas ça sur le compte du comportement de mes congénères précédents, mais sur la servilité obséquieuse, due à la cupidité infamante du responsable de l’albergue el alfar, sise à Hornillos. Mais ne gâchons pas tout, parce que je suis dans la meseta, je m’éclate en appuyant sur les bâtons, j’oublie tout. Et je ne veux pas que mes turpitudes deviennent moindres, je veux qu’elles disparaissent irréversiblement. Je parle de toutes ces pensées qui s’enchevêtrent et qui vous font perdre la clarté de l’esprit, l’essentiel de la vie, la compréhension des autres. Refouler la charpie du cerveau des temps modernes, voilà ce qu’il fallait que je fasse! Vivre sans rien dans la tête, même si je perds mon acquis, vivre sans pression et besogner en sifflotant. Quitte à changer de vie, j’irai cheminer comme un cheminot, celui qui corve à longueur de journée et ne peut qu’observer les rails sur leurs ballasts, à l’infini. Je vais éteindre ma vie d’avant comme on sort d’une pièce et faire un travail de trimard, avec ces gens sans passé, ceux au QI zéro, ceux vides de mémoire, ceux sans âme. Tiens, j’ai une idée, j’irai ramasser du coton avec les négros dans les champs d’Hornillos. Je dis négro par facilité, parce que, dans le coin, je ne connais pas la marque des noirs serviles et parce qu’ici, chez el alfar, on ne connait pas encore l’abolition. Mais revenons à un présent beaucoup plus intéressant. Près d’une fontaine, où je faisais refroidir ma mécanique, une jeune fille d’une vingtaine d’années, me demanda en anglais, avec un fort accent bien de chez nous : — Vous pensez qu’elle est bonne cette eau ? Elle se tenait devant la fontaine, j’eus un moment d’hésitation, me demandant ce qu’elle foutait là avec une question aussi saugrenue, parce qu’on n’est pas là par hasard. Si elle se posait encore ce genre de question, sa présence ici tenait du miracle. Personnellement, et depuis longtemps, l’instinct avait pris le dessus, il me faisait humer, goûter et me faisait observer les alentours ; trop près des villes ou à trop basse altitude, cette eau qui vient de loin, il faut l’éviter. Autant de détails pour savoir si source je boirai de ton eau. Dans cette région, de toute façon, je ne buvais plus que de l’eau minérale. Je lui fis donc état de ces quelques détails et de mon expérience, en lui exposant, non sans ambages, les possibles effets de l’eau, appelés tourista par les initiés. Sa gourde était remplie, elle était là, immobile, semblant attendre et, comme nous n’étions que tous les deux dans le paysage, je lui dis, comme un jeune homme bien élevé: — Vous voulez que l’on fasse quelques pas ensemble ? Je rigole encore de cette emphase de formule bien policée, qui se veut non effarouchante. — Bien sûr ! me répondit-elle avec un grand sourire. Et, tout d’un coup, ça a fait tilt ! Cette fille était la copie conforme de Julien, son clone. Dommage qu’il ne soit pas là, il aurait kiffé sa sœur jumelle. Ils étaient à l’identique : les yeux, l’allure, et puis ce long nez en trompette qui les font ressembler à gobe-lune. S’ils s’étaient rencontrés, ils nous auraient fait un petit angelot appelé Pinocchio et, pour une fille, Alice. Nous étions dans une belle côte et je lui dis : — Il faudrait ralentir si on veut arriver là-haut. Plus loin il y a au moins huit pour cent de dénivelé. — Huit pour cent, comment tu le sais ? — L’habitude. — Comment on peut prendre cette habitude et savoir s’il y a huit et pas vingt pour cent ? Elle venait de m’apprendre qu’elle était étudiante pour être chercheur en biologie. Aussi je la dévisageais cherchant une trace d'ironie ou, tout au moins, d’humour ; non, rien qu’une espèce de candeur que seule une gamine avec sa tête peut avoir. Me demandant ce que l’on peut bien apprendre dans une université canadienne, je lui dis : — Regarde mon bâton, il fait un mètre. Si je le mets à plat sur la route, je n’ai plus qu’à mesurer à son bout. Et s’il y a huit centimètres cela fait huit pour cent centimètres. Capito ? — Super ! J’ai appris quelque chose aujourd’hui ! Mais comment tu fais pour savoir que ton bâton est à plat ? Elle commence à m’énerver celle-là, avec ses questions à la con ! Et, joignant le geste à la parole, je sors une bouteille d’eau. — Pour mettre quelque chose de niveau, on prend un niveau et, quand on n’en a pas, on pose une bouteille couchée dessus. Quand la bulle d’air est au milieu, le bâton est de niveau, et tu n’as plus qu’à mesurer. Elle était tellement contente qu’elle a failli m’embrasser. Pour moi, il suffisait de réfléchir cinq minutes, ou bien elle avait peut-être déjà été attrapée par le syndrome de la solitude dans les grands espaces. Les grosses têtes seraient-elles dépourvues de bon sens ? Décidément, je regarderai les chercheurs et autres rats de laboratoires différemment. Elle s’appelle Pénélope, née en Suisse et habitante du Québec; après le divorce de ses parents, sa mère l’a littéralement amenée dans un baluchon à Montréal. Inutile de dire qu’elle a dû en voir. Pour être là, elle a fait une saison de plusieurs mois de ramassage de fraises et, avec le fruit de son travail, s’est payée le pèlerinage. Sa grand-mère habitant Paris, elle était partie de Tours depuis trois mois. Je lui fis remarquer que j’avais fait un chemin aussi long et que je n’étais parti que depuis un mois et demi, et j’ajoutai, taquin, qu’elle n’avait pas un très bon rendement. — C’est parce que j’ai une autre activité sur le chemin : je peins les pieds. — …..…..( ?) Bon, elle commence à me courir la Pénélope, là. Je vais me la farcir vite fait, si elle continue à me prendre pour une truffe. — J’arrive le soir et je peins les pieds des pèlerins en leur parlant. En plus elle leur parle ! Elle parle à des pieds, cette fille est folle à lier; bon c’est décidé, à la première occasion je la largue n’importe où. Pour l’instant, du calme. — Si tu veux, ce soir je peins les tiens. Je l’imaginais assez mal me barbouillant les pieds en baragouinant des rites vaudou ou je ne sais quoi. Je restai le plus placide possible et lui dis : — Oh tu sais, moi je n’étale que de l’huile essentielle sur mes pieds. — C’est vite fait tu sais, tu pourras mettre tes huiles après. Elle insiste en plus. Moi qui sortais d’un discours avec moi-même, grandiloquent et stupide, sur mes états d’âme, je tombais sur cette folle. — C’est-à-dire que je marche tard le soir. — Mais on peut s’arrêter dans un bistrot. — Non, le temps de me laver les pieds et tout. — Non ce n’est pas nécessaire. En plus elle est crade, je voyais bien un mélange de crasse et de peinture dégoulinante sur mes pieds. J’eus l’idée d’un plan B pour couper court à la conversation sans la perturber : j’allais mettre mon mp3 dans les oreilles. — ………. — Moi, ma technique pour ne pas que ça dégouline, je souffle dessus. Elle lit dans mes pensées en plus ! Une sorcière au minois d’ange. Je me demandais quel genre de peinture elle pouvait bien utiliser ; elle m’intriguait de plus en plus. — Peindre des pieds qui puent ne te gêne pas ? — Non, je suis suffisamment éloignée. Elle peint à la Pollock*, en plus. Elle balance la peinture ! Je me demandais si elle prenait beaucoup d’élan ; je vois d’ici la terrasse du bistrot. Je me suis dit : la pauvre, à son âge, elle cumule les tares : un lobe du cerveau de chercheur déjanté et l’autre consacré à une peinture incongrue. *Pollock : peintre abstrait, dont la technique consiste à jeter des seaux de peinture. — Mais quand tu souffles dessus, comment tu fais ? M’attendant à ce qu’elle me réponde, je prends une maxi paille pour souffler, elle me dit : — J’ai appris ça aux Beaux-arts, faire sécher l’aquarelle. Je partage mes études scientifiques avec la peinture. Pour le chemin, je peins des pieds parce que je participe à un concours de la « plus grande radio française culturelle ». Je dois rendre le dossier avant la fin de l’année. Mon sujet est : dessin et destinée. Le cadre du concours doit être l’intimité des gens dans un environnement commun. Compostelle me semblait bien et les pieds sont ce que nous avons de commun, à la fois de commun et d’intime. Voilà pourquoi je viens d’aussi loin. Je vais raconter l’histoire de pèlerins, illustrée par des aquarelles. Je n’avais plus qu’à me trouver un fossé et m’enterrer six pieds sous terre. Si je ne savais pas pourquoi j’étais parti, elle, la gamine, la foldingue le savait. Elle avait un projet, une belle raison, un moyen légitime et sans voyeurisme, pour faire raconter et raconter la vie des autres. Quel beau voyage elle devait faire ! J’étais honteux, depuis tout à l’heure je lui parlais comme à une demeurée. J’aurais voulu rembobiner le fil de la conversation, si je l’avais pu. Désolé, ô Pénélope. Quelques kilomètres plus loin, nous fîmes une halte au bord d’un bassin, nous vîmes arriver une 205 blanche, un peu souffreteuse, qui ne semblait pas avoir aimé la fameuse montée ; une odeur de cramé s’élevait du capot. Un type en descendit, c’était celui devant lequel nous étions passé un moment plus tôt, la seule personne aperçue de la matinée, d’ailleurs, à part Pénélope ; il nous avait souhaité un « holà bon camino ». Ce matin, il avait devant lui deux tréteaux et quelques fruits sur une planche. Il attendait placidement le pèlerin en mal de réconfort glucosique. Visiblement son chiffre d’affaire de la journée était clos. Il descend de sa voiture en surchauffe, ouvre le capot, met la main sur le bouchon du radiateur et ‘heureusement’ se brûle un peu. Il va chercher un chiffon, ce qui me donne le temps d’intervenir, pour l’empêcher de se faire ébouillanter. Sur ce, un autre Monsieur, plus âgé, arrive du côté opposé. Il y avait décidemment foule ici. Lui, parlait un peu mieux le français ; je m’en servis donc pour traduire les quelques rudiments mécaniques dont je me souvenais : attendre avant d’ouvrir, mettre de l’eau jusqu’en haut du radiateur et rouler vitres ouvertes avec le chauffage et la ventilation à fond. Pénélope parlait maintenant avec ce Monsieur et le vendeur de fruits qui avait les traits et le même air éveillé que Villeret. Je me suis dit : tiens, serait-elle en chasse ? Ayant l’esprit de meute, et surtout la même idée derrière la tête, je leur offris une cigarette pour les retenir un peu. Malgré tout, je n’ai pas pu faire conclure Pénélope. Dommage, ce Villeret aurait eu des choses à raconter depuis le temps qu’il voit passer des pèlerins. Nous nous arrêtâmes dans une albergue-resto et, pour la première fois, je me fis un vrai repas à midi, avec des frites et tout le toutim bien gras. Elle bâfrait plus que moi et autant qu’Anahée. Le chemin ça creuse, visiblement. Pénélope se montrait insistante, non pas pour relooker mes pieds, mais pour les peindre. J’étais flatté, mais je n’avais pas envie de me faire raconter et un jour, qui sait, d’être cité. Dommage, les pieds, c’est ce que j’ai de plus beau et ils sont toujours cachés. Et surtout, dommage que ce ne soit pas un organe de séduction, car j’en ai deux, en plus. De beaux pieds grecs, dont le second orteil, dépassant les autres, dessine un triangle parfait, ceux appelés flamme, qui dénotent un caractère époustouflant ! Pour m’en sortir pendant le repas, comme le salaud de délateur que je suis, je lui parlai de J.-Pierre, l’extraterrestre rencontré au tout début. Je pourrai toujours lui envoyer une photo de mes pieds par mail ; après tout, j’avais été son compagnon de route. Elle ne perdait pas une miette de ce que je lui racontais, me faisant répéter ou reformuler certains détails. Aujourd’hui j’ai changé, j’ai envie de dire, je m’étale à tel point que j’ai l’impression que tous ces mots qui arrivent, tellement ils sont disjoints, en dégoulinent sur l’écran ; je dois être plein de contradictions, mais à l’époque c’était avant le chemin. Je la quittais, prétextant que le compte à rebours sur le chemin tournait depuis la réservation du vol de retour. Un personnage, cette Pénélope ! Je la quittais avec regrets ; quand je partis, elle était encore à table. Je sentis son regard sur moi, ou plutôt sur mes pieds. Lui tournant le dos, je ne pouvais lui montrer que mes semelles rouges, façon Lou Boutin. * |